« La sobriété heureuse par la planification démocratique » : un pas de géant pour le social et l’écologie
- Camille Robert
- 17 oct. 2024
- 4 min de lecture
Le courant de La Montagne s’inscrit pleinement dans les démarches de l’anticapitalisme, et allant encore plus loin, de la décroissance économique.
Près de deux siècles de capitalisme mondial auront eu pour effet de faire considérer à toute la population que la « bonne santé » d’un Etat est dû à sa « bonne santé » économique. Pour cela, un instrument de mesure et une dynamique s’imposent : le PIB, et la croissance constante de ce dernier.
Le PIB est, pour schématiser, la somme de toutes les richesses produites au sein d’un Etat pendant un temps donné (souvent une année), que ce soit celles produites par une entreprise, ou celles tirées des impôts. Il ne s’agit donc que d’un outil économique. Il ne mesure en rien la qualité de vie des habitant.e.s dudit pays, et ne s’intéresse pas non plus au bilan écologique de ces productions. Ce n’en est que la mesure, un outil, avec un but clair. Néanmoins, il est utilisé par le capitalisme de manière particulièrement abusive, alors-même qu’il souffre de plusieurs failles, parmi lesquelles :
Comme dit plus haut, une non-considération des enjeux autres que l’économie, alors-même qu’une économie a pour vocation de s’inscrire dans une société ;
Une très importante imprécision, et un besoin constant d’être mis « sous conditions » pour obtenir un semblant de pertinence : le PIB de la Chine est le deuxième PIB étatique le plus élevé au monde. Néanmoins, quand il est rapporté au nombre d’habitants, le Luxembourg prend cette deuxième place, et la Chine termine à la 80ème place (entre la République dominicaine et les Palaos). Idem d’ailleurs rapporté au coût de la vie dans un Etat : on parle de PIB par parité de pouvoir d’achat (« Liste des pays par PIB (PPA) par habitant », dans Wikipédia, 2024 (en ligne : https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_des_pays_par_PIB_(PPA)_par_habitant&oldid=212754401 ; consulté le 26 juillet 2024)) ;
Le PIB est donc peu fiable. Et pourtant, il est scruté chaque année avec la plus grande attention par les organes et institutions économiques étatiques et internationales pour voir si, oui ou non, il a augmenté comparativement à l’année passée : c’est la croissance économique. La course à la croissance économique est le grand absolu du capitalisme : après tout, si un Etat voit sa croissance augmenter, cela veut dire que ses habitant.e.s sont riches, non ?
C’est faux, et pour deux raisons :
La redistribution des richesses sous le capitalisme, passe d’abord par la poche des grands groupes, et donc des grands patrons, puis dans celle des actionnaires, puis – enfin – l’Etat, et les miettes restantes vont aux travailleu.r.se.s ;
Là encore, tout est question de parité de pouvoir d’achat et nombre d’habitant.e.s.
C’est le premier problème du capitalisme, que l’on peut qualifier d’« historique » : le capitalisme appauvrit les plus pauvres, et enrichit les plus riches, sous couvert de faire profiter « l’Etat dans son ensemble ».
Le second problème, encore mal connu, et très peu documenté jusqu’à assez récemment, alors-même qu’il est tout aussi important, sinon plus que le premier, est celui de l’écologie. Pourquoi « plus » ? C’est assez simple : de la richesse sans Terre, cela est peu utile. C’est le fameux adage « l’argent ne se mange pas ».
Nous le savons, les ressources terrestres sont finies, et tous les jours, on nous rappelle que l’épuisement des ressources est pour bientôt (10 ans, 20 ans, 50 pour les plus optimistes). Ces ressources sont celles qui font pourtant tourner l’économie : pétrole (pour le plastique également), gaz, minerais, etc., et qui, non contentes de s’épuiser, participent à la pollution générale, et donc à menacer la survivabilité terrestre (conf. les 9 limites planétaires, encore trop peu connues alors qu’elles sont au coeur de tout le débat écologique).
Et maintenant, l’équation semble simple :
Production se voulant infinie pour satisfaire le besoin de croissance + caractère (très) fini des réserves des ressources nécessaires à la production + pollution d’un environnement déjà très pollué = incompatibilité flagrante.
Nous sommes dans un avion, au milieu de l’Atlantique, et dont les réservoirs sont dangereusement bas. Deux solutions s’offrent à nous pour éviter le crash :
Pousser les moteurs, et tirer sur le manche, pour faire grimper l’avion le plus haut possible avant que les réservoirs ne soient à sec, dépensant au passage exponentiellement toujours plus au fur et à mesure de la hauteur gagnée, pour ensuite planer vers le continent, et espérer avoir encore suffisamment de vitesse pour 1/ atteindre ledit continent, 2/ réussir à se poser sans s’écraser (la « solution » telle que proposée par les tenants de la « croissance verte », qui n’a de verte que les lettres avec laquelle elle est écrite sur les panneaux publicitaires) ;
Réduire la vitesse, garder une altitude constante, voire la baisser un peu, quitte à remettre de temps en temps des petits coups de moteurs pour ne pas décrocher, et conserver suffisamment de carburant pour tout à la fois atteindre le continent, mais aussi pouvoir se poser en toute quiétude (notre solution).
La Montagne préconise la solution de la sobriété : la sobriété dans notre consommation énergétique, certes, dans notre consommation alimentaire, bien sûr, dans notre mode de vie, mais aussi dans notre économie. Cela implique de ne pas avoir peur de dire « stop », et d’accepter que notre économie puisse décroître. « Décroître », insistons dessus, et non pas s’effondrer. La décroissance est, à tort, souvent confondue avec la déflation, alors que la première est parfaitement contrôlée et contrôlable.
Mais, quelle décroissance ? Nous n’estimons pas qu’une décroissance sur tous les domaines de l’économie soit une bonne chose, et nous pensons même que certains de ces secteurs, sociaux notamment, méritent au contraire une croissance : santé, éducation, subventions servant à une réelle transition écologique (et non pas une accumulation des différentes sources de production d’énergie), entre autres. De l’autre côté, les secteurs sur lesquels nous souhaitons exercer cette logique de décroissance sont ceux liés au capitalisme, comme la finance, les énergies fossiles, la vente d’armes, etc.
Par la sobriété, et ce pilotage entre décroissance et croissance, nous entendons 1/ lutter contre les atteintes environnementales causées par le capitalisme, 2/ mieux prendre en main la production, et ainsi participer à une meilleure redistribution des richesses, sans être sous la constante logique de la compétition qu’implique la croissance du PIB.
La Montagne appelle donc à la sobriété dans une double optique sociale et environnementale.
Camille Robert


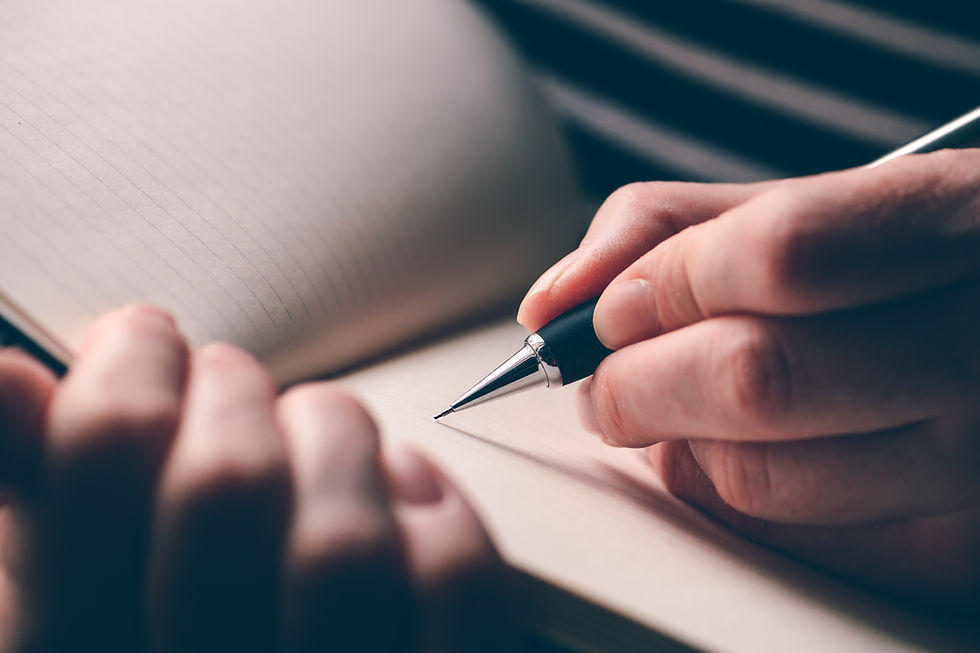

Commentaires